Sciences du démantèlement des installations nucléaires
Académie des sciences
2h23min15
- Sciences de la vie et de la nature
-

-
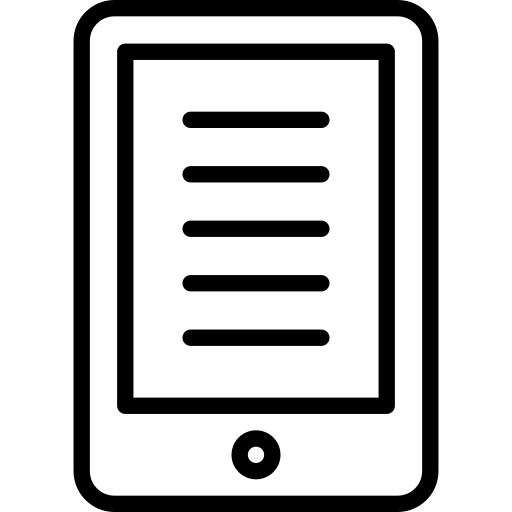
191 pages. Temps de lecture estimé 2h23min.
En France, neuf des réacteurs nucléaires de production d’électricité sont arrivés en fin de vie et sont en phase de démantèlement, afin de rendre leurs sites libres pour tous usages. En outre, sur les 58 réacteurs électronucléaires en fonctionnement, 48 devraient arriver en fin d’exploitation avant 2050. Cette situation est commune aux nations industrialisées exploitant l’énergie nucléaire : dans la seule Union européenne, il y en a 75, aux États-Unis, il y en a 29.Ces chantiers de démantèlement ont des caractéristiques qui les distinguent des autres chantiers de démolition.Ils contiennent des matières radioactives, dont l’exposition externe aux rayonnements, l’ingestion ou l’inhalation accidentelle pourraient constituer des dangers. Les phénomènes associés à la radioactivité sont des obstacles au travail des hommes et à la mise en oeuvre des procédés classiques de démolition. La radioprotection joue donc ici un rôle central.Des techniques, des appareils et des procédés spécifiques ont été mis au point par les opérateurs spécialisés, et, de ce point de vue, les équipes françaises ont développé un savoir-faire scientifique et technique reconnu internationalement.Les 8 et 9 octobre 2014, l’Académie des sciences a consacré un séminaire aux sciences et techniques du démantèlement des installations nucléaires, au cours duquel ont été débattus tous les aspects de ces disciplines : la caractérisation des sources de radioactivité, la radioprotection, la logistique, la physicochimie, la mécanique des milieux continus, les codes de calcul, la robotique, les retours d’expériences, la formation, la prospective et le cas des accidents graves…L’objet de cet ouvrage est de rendre compte de ces journées d’étude et de dresser un panorama des besoins et conditions du démantèlement, de recenser les phénomènes scientifiques clés, de décrire les recherches en cours et d’identifier celles à mener pour permettre le retour au libre usage des sites d’installations électronucléaires, tout en assurant la protection des travailleurs et du public pour le présent et pour l’avenir.

